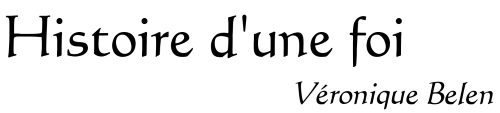Avec le retour de la pluie, plonger mes mains dans la terre me manque déjà. Je ne pensais pas être gagnée un jour à ce point par la passion du jardinage. Mais entre confinements et temps retrouvé, j’ai été gagnée par cette fièvre qui saisit les jardiniers amateurs du printemps à l’automne.
Quand ma vie était dévorée par le labeur professionnel, je me désolais régulièrement de l’aspect un peu négligé des abords de ma maison. Mais on ne peut pas tout mener de front quand on on a un métier chronophage et qu’on vit en solo. Les vacances suffisaient à peine pour fleurir la terrasse et quelques recoins du jardin, et les week-ends pour tondre la pelouse.
A la faveur de ma liberté retrouvée et du premier confinement, j’ai eu le goût de me mettre au potager. Ma terre caillouteuse est on ne peut plus ingrate. J’ai donc mis en place un potager en carrés surélevés, passant en quelques mois d’un seul carré à sept. Rien que la mise en place était déjà un labeur plaisant. Billes d’argile, terre, compost, terreau, les strates à élaborer me laissaient le loisir d’imaginer des légumes goûteux à la belle saison et jusqu’à la fin de l’hiver. Entre brouettes à charrier et mal de dos, je retrouvais avec jubilation les gestes ancestraux de mes aïeux agriculteurs.
Jusqu’à l’année dernière, j’avais encore le bonheur de m’asseoir sous le chêne en fin d’après-midi, téléphone en main, pour partager à mon papa mes travaux du jour et lui demander ses conseils avisés. Lui déclinait dans la fatigue de l’âge et perdait le goût de cultiver son grand jardin, mais il se réjouissait de mon enthousiasme pour la terre et me prodiguait ses commentaires bienvenus. Il riait de mes semis au mois de février : “Mais pourquoi es-tu si pressée ?” Et j’étais fière de lui dire plus tard que si, mes radis avaient germé et qu’en les protégeant du gel les nuits de frimas, j’avais la chance d’en consommer déjà début avril. Son savoir était sûr et séculaire. Moi je me targuais de lire beaucoup de conseils sur le net et de jardiner avec la lune et la météo à long terme. Deux expériences de la culture se confrontaient et s’enrichissaient mutuellement, la sienne si longue et si ancienne, la mienne plus empirique et tenant compte des évolutions climatiques récentes. J’aimais l’entendre me raconter que sa mère avait pu ressemer une seule fois dans sa vie au cours du même été ses propres graines de haricots, quand ils étaient déportés dans la Vienne au début de la seconde guerre mondiale, et que la habitants de leur village d’accueil leur mettaient à disposition des lopins de terre pour qu’ils puissent se nourrir. Cette anecdote aussi, quand mon grand-père, libéré, les rejoignant là-bas, avait poussé une gueulante en allemand contre des occupants qui venaient piller de nuit les petits potagers des réfugiés. Il les avait couverts de honte dans leur langue natale, ce à quoi ces jeunes soldats allemands ne s’attendaient pas du tout de la part d’un courageux père de famille lorrain échoué dans l’ouest.
Ainsi, les mains dans la terre, je me sens en communion avec mes ancêtres dont c’était le seul gagne-pain, et j’aimerais transmettre à mes enfants un peu de ce savoir séculaire qui m’a toujours impressionnée. La joie de voir germer, pousser, donner du fruit, le plaisir simple de consommer sa propre production sans chimie et sans transports lointains.
Et j’ajouterai que je trouve dans le jardinage quelque chose de mystique également : travailler la terre nous rapproche du Créateur, il y a là de Sa propre expérience de don de la vie. Retrouver sa vocation biblique de gratteur de terre expulsé provisoirement de l’Eden. On a toujours la possibilité de tenter de faire ressembler son propre jardin à un petit paradis fleuri et nourricier. Et de cultiver encore et encore l’espérance, quand, semant la graine, on imagine déjà la plante et le légume mature à point pour régaler la maisonnée.
Oui, travailler la terre prend aussi une dimension proprement divine. Je me sens, dans cette activité, reliée à la fois aux profondeurs du sol et à l’infinité du ciel.