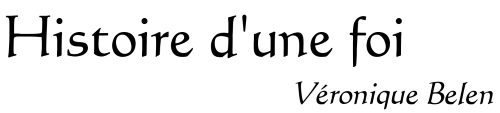Hier, je suis allée au cinéma pour voir “Gloria Mundi” de Robert Guédiguian, un film sombre, difficile, sans concession pour notre société injuste, où les uns, d’un milieu social modeste dans les quartiers nord de Marseille, s’éreintent au travail pour à peine survivre tandis que d’autres jouent les parvenus, prospérant dans des affaires troubles qui ne consistent qu’à tirer profit de la précarité d’autrui : rachat d’objets dont on se défait pour “boucler ses fins de mois” et qui sont ensuite revendus après avoir été réparés dans des ateliers clandestins de travailleurs non déclarés, eux aussi précaires entre les précaires. Le réalisateur nous amène à l’amer constat de la misère à nos portes, dans nos sociétés d’opulence pour certains, de désespérance pour beaucoup d’autres. Je retiendrai l’image du visage décomposé de Sylvie, femme de ménage quinquagénaire honnête et besogneuse admirablement interprétée par Ariane Ascaride, lorsque son chef d’équipe sur un paquebot lance “Neuf minutes par cabine !”, et qu’en train de se démener pour y parvenir, elle découvre des toilettes dans un état nauséabond. Souvent, j’ai souligné ici le mérite des femmes de ménage que l’on ne pense jamais à louer, elles sont méprisées comme leurs tâches, alors que sans elles, nos lieux publics seraient invivables.
En proie à des pensées encore noires après ce film à l’issue implacable, je me retrouve dans la salle d’attente d’un médecin qui a pris du retard dans ses rendez-vous. Il faut prendre patience quand on se rend compte que plusieurs patients vous précèdent alors que vous étiez bien à l’heure.
Il y a là un couple, elle, la patiente prévue après moi, s’agite un peu, parle avec tout le monde, descend fumer une cigarette, remonte et commente l’amertume de sa vie : un accident grave qui l’a handicapée depuis vingt-cinq ans, le moral fluctuant, l’impossibilité de travailler, la précarité financière, l’envie quant aux personnes “joyeuses et qui ont tout.”
Je n’aime pas beaucoup les conversations de salle d’attente, mais entre ses paroles incessantes et un coup de fil que passe son mari, j’en sais déjà presque trop sur leur pauvre vie.
Elle évoque une fillette, leur petite-fille je suppose, qui veut venir dîner chez eux de “pommes de terre au munster.”
“Le grand munster était à 5 ou 6 euros, dit-elle à son mari, j’en ai pris un petit, tant pis, je n’en mangerai pas, moi, je lui laisserai ma part.”
Parfois, le cinéma ne reflète que la triste réalité.
Image : Pablo Picasso Les pauvres au bord de la mer XXe National Gallery of Art, Washington