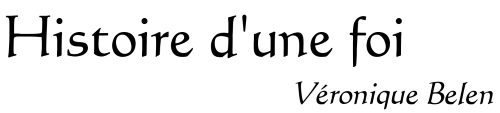Cette date me revient en mémoire chaque année, et même hors de toute commémoration dans la presse ou la sphère politique.
10 mai 1981. Je ne pourrai jamais oublier.
10 mai 1981, j’avais 17 ans, j’étais une brillante élève de première littéraire et je sortais d’une enfance marquée par la précarité financière de mes parents. Oh, je n’ai jamais eu faim de ma vie, ni froid, ni manqué de soins, mais j’étais frustrée de tout l’agréable, le culturel, et bien sûr le superflu que je voyais à la portée des jeunes filles de mon âge : vêtements à la mode, sorties, loisirs selon leurs goûts – j’aurais tant et tant aimé apprendre à jouer du piano ! – voyages, argent de poche permettant l’achat de disques ou de livres, et surtout possibilité d’envisager les études de mon choix. Un cursus universitaire long et coûteux m’était proscrit, une école supérieure payante encore davantage. L’Ecole Normale d’Instituteurs rémunérée était la seule solution raisonnablement envisageable, l’unique tremplin social possible dans ma famille. Mon père, bien qu’homme intelligent, méticuleux, sérieux et fiable depuis toujours dans son travail de menuisier au service d’un patron localement prospère dans l’ameublement, avait passé toute sa carrière au SMIC. Par pudeur et solidarité avec ses collègues, il n’aurait jamais quémandé une augmentation, même si le quotidien était rude. Il endurait la double journée : travail éprouvant de livreur et monteur de meubles pendant des années, et travaux agricoles à la maison pour parvenir à nourrir et éduquer dignement quatre filles. Nous étions sa fierté et ses projections d’avenir : en réparation de sa scolarité fauchée par la seconde guerre mondiale, nos bons résultats scolaires lui faisaient espérer pour nous l’ascenseur social qui n’était pas une chimère à cette époque-là. Notre mère, humble femme au foyer, gérait au mieux ce budget serré. Les écarts et la fantaisie n’existaient pas, ni pour elle, ni pour nous. Je lisais l’angoisse des fins de mois difficiles et des livrets d’épargne vides dans ses yeux et ses reproches quand je me plaignais d’être moquée au lycée pour mes vêtements démodés.
10 mai 1981. Depuis longtemps, mon père votait à gauche, sans effet et sans grand espoir. Moi j’étais militante à la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) et la classe ouvrière était mon terreau et ma blessure. Au lycée, notre prof d’histoire était une femme ouvertement de gauche. Son enseignement prenait une couleur qui nous marquait et nous influençait indéniablement. Nous n’avions aucun mal à la suivre dans ses aspirations à un nouveau Front Populaire. Une seule élève de ma classe se rebellait, mais comme elle représentait à l’époque tout ce que je fuyais – le tabac, Johnny Halliday et la droite – mes aspirations à un pouvoir socialiste me semblaient des plus légitimes.
10 mai 1981. J’étais devant la télé avec mon père quand le résultat de l’élection présidentielle s’afficha à vingt heures. Cris de joie et débordement d’allégresse, bonds de “Hourrah” en tous sens : François Mitterrand était élu ! Enfin ce sentiment d’exister, d’avoir été entendus, de pouvoir envisager un autre avenir ! Enfin ne plus se sentir du côté des sans-voix, des exploités, des parias de la société !
La liesse populaire qui s’en suivit me touchait en plein cœur. La marche de notre nouveau Président de la République, la rose socialiste à la main, me transportait de joie et d’espérance en des jours meilleurs.
Bien sûr, au fil des années de ses deux mandats, les désillusions se feraient jour : fuite des capitaux, guerre scolaire, dévaluations du franc puis “rigueur”, déconnexion de la base de la part de ce qu’on appelait alors “la gauche caviar”, réalisme nécessaire en comprenant que le budget de l’Etat et les détenteurs des capitaux ne permettraient jamais que les aspirations populaires soient satisfaites. Si, dans mon quotidien d’élève-institutrice rémunérée, les choses allaient s’améliorer pour moi un an plus tard, je continuais par ma militance JOC à déplorer l’exploitation des ouvriers, des apprentis, des enfants de l’immigration qui n’avaient toujours pas plus de perspectives que moi-même naguère. Nous avions été transportés d’une immense espérance, mais rien ne changeait vraiment, si ce n’est que nos “adversaires” de droite ne se cachaient plus désormais de leurs vues et s’autorisaient alors tous les sarcasmes contre les électeurs désillusionnés de “Tonton”.
Pourquoi cet article aujourd’hui ?
Parce que le 10 mai 1981 gardera pour moi à jamais le parfum d’une victoire et d’une joie incommensurable partagée avec mon père et tous ceux de notre classe jusque là délaissée.
Parce que les discours populistes et démagogiques qui ont cours de nos jours dans notre pays de la part des deux extrêmes de l’échiquier politique me révulsent. Dans les années 80, on ambitionnait pour son prochain issu de l’immigration des jours meilleurs, et non de le jeter tout simplement dehors. On ne mêlait pas comme aujourd’hui politique et réformes sociétales plus ou moins heureuses à long terme. On croyait fermement en l’Europe. On n’encourageait pas la violence de rue. On désirait encore s’exprimer par le bulletin de vote et pas par la force. On ne s’originait pas sans complexes dans les courants politiques les plus nauséabonds jadis. On ne croyait pas encore à la toute-puissance des discours oratoires dominant les médias. On avait quelque pudeur qui empêchait d’étaler avec arrogance son patrimoine.
Je ne suis pas du tout passéiste. Par contre, j’ai mal à ma patrie. Je ne me reconnais aucunement dans les extrêmes dont je mesure d’ores et déjà les dangers s’ils parvenaient au pouvoir, que ce soit d’un bord ou de l’autre Je désapprouve le fait que la rue se sente plus légitime que les urnes. Et j’ai bien du mal désormais à m’enthousiasmer pour tel ou tel projet politique. Je n’ai que trop vu, au long d’une carrière de quarante ans dans l’Education Nationale, que les alternances politiques n’avaient jamais su améliorer le sort des plus défavorisés de la nation ni empêcher l’écroulement tragique d’un système éducatif, symptomatique de la mauvaise santé d’un Etat.