Ce matin, j’ai eu envie de la prendre, cachée derrière toutes les autres, pour y boire mon café du matin. Elle est bien à l’abri au fond du placard parce qu’elle est précieuse entre toutes. Et d’ailleurs, une des hantises de ma fille, c’est de la casser en rangeant la vaisselle. Elle a compris tout le poids affectif qu’il y avait pour moi dans cet objet.
J’ai pris ma tasse, plus arrondie que les mugs d’aujourd’hui, et j’ai laissé tous les souvenirs remonter.
Il ne pouvait plus vivre seul dans son grand presbytère un peu vétuste. Le temps était venu pour lui de tourner la page après des décennies de ministère fidèle. Mon grand-oncle avait choisi une maison de retraite pour y finir, entre résidents prêtres, sa vie. Il lui fallait vider la maison.
J’étais jeune, je m’installais, j’avais encore peu de meubles.
“Regarde ce buffet, tu le veux ?”
Il n’avait pas fière allure. J’ai dit oui plutôt pour lui faire plaisir.
“Tu peux avoir aussi toute la vaisselle qu’il y a à l’intérieur.”
Un service complet couleur crème, à l’allure ancienne, plaisant à imaginer sur ma table. Je n’ai pas trop l’habitude que l’on me donne quelque chose. J’étais émue de tant de générosité.
Le buffet, passé entre les mains expertes de mon père menuisier, est devenu une merveille. Il restera le plus beau meuble de ma maison. Avec toute la vaisselle à l’intérieur…
Quand je bois dans cette tasse égarée seule dans le service, je repense à lui. A lui, humble et affectueux, à son grand corps un peu maladroit, à une tache souvent sur son costume, à son bon sourire qui le faisait ressembler à Jean-Paul II – c’était la première réflexion qui nous était venue en découvrant le visage de Karol Wojtyla, un peu plus jeune que lui, en 1978. Un prêtre tout en bonté et en simplicité. Nous étions ses seules petites-nièces, et il aimait poser des questions sur nos projets d’avenir. Il nous serrait maladroitement dans ses bras avec un petit rire.
Il s’en est allé un jour de juin il y a vingt-cinq ans, et le peu de décence avec laquelle fut traitée sa dépouille est resté un sujet de blessure pour ceux qui l’ont vu là. Une vie donnée aux autres entrait dans la Vie. Une profonde cicatrice pouvait se refermer. Sans doute allait-il la retrouver, elle, sa maman, qui lui avait été arrachée quand il avait trois ans. Ma famille porte un lourd traumatisme, l’histoire de la rudesse de la vie rurale qui peut ruiner affectivement plusieurs générations.
Août 1916. Un orage, la nuit. Elle a 43 ans, elle attend son neuvième enfant – deux sont morts en bas âge. Son mari lui dit qu’elle doit se lever, qu’il faut rentrer la paille. Ils rentrent la paille.
Quelques jours plus tard, elle meurt, emportant l’enfant avec elle.
La fille aînée a seize ans. Ma grand-mère, sept. Le petit dernier, celui qui deviendra prêtre, trois ans à peine. Ils ont grandi sans maman. Toute une génération sans tendresse, qui ne saura pas en donner non plus à la suivante. Et la suivante qui perpétuera ce traumatisme initial en ne sachant pas les mots, les gestes…
“Rompez cette chaîne”, m’avait dit un psy.
Ce n’est pas toujours facile, car il y a une maman sacrifiée dans l’arbre généalogique.
Alors, mon café dans cette tasse-là a un goût particulier, le goût de la filiation, de la transmission, de la perpétuation du souvenir et de l’héritage spirituel.
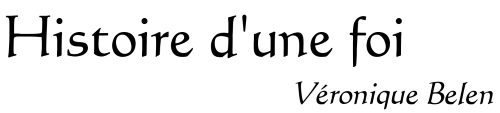









2 commentaires
J’aime bien Véronique quand vous écrivez des textes personnels comme celuid’aujourd’hui.
Marie-Andrée – 86 ans – Angers
Merci Marie-Andrée, bienvenue !