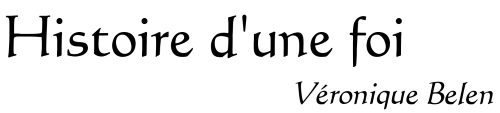Née à proximité de trois frontières, je me suis toujours dit que c’était une chance. L’ailleurs était tout près. On passait une douane – et il fallait s’y arrêter à l’époque – et quelque chose changeait. La langue, la façon de se nourrir, les panneaux routiers, l’architecture… Mes grands-parents et mes parents avaient beau raconter souvent d’amers souvenirs des deux guerres, il n’y avait pas chez nous de haine de l’Allemand. Bien au contraire. Très tôt, ce fut pour moi une terre amie, une terre d’amis. J’aimais aller là-bas, dans cette famille que j’avais un peu faite mienne, où j’apprenais à me débrouiller dans cette langue apprise consciencieusement dès le collège, j’aimais m’asseoir à côté de ma correspondante et l’écouter jouer du piano, c’était une virtuose. Que de bons moments passés ensemble, jusqu’à l’âge adulte qui nous unit toujours dans l’amitié !
Je me suis éloignée de cette portion-là de la frontière, mais rapprochée du Rhin. Le Rhin calme et majestueux, qu’il suffit de passer pour être un peu dépaysée déjà, l’urbanisation plus poussée, les espaces verts soignés, les vélos, le Kaffee-Kuchen de l’après-midi, la langue jamais oubliée qu’il faut réutiliser.
Nous avons trouvé un prétexte à passer le Rhin régulièrement : tous les produits d’hygiène sont là-bas considérablement moins chers. Alors on fait le plein pour quelques mois, et on profite de la sortie pour se balader au bord du fleuve impressionnant, dans son roulis tranquille qui semble nous dire que les conflits sont définitivement passés et que des nations jadis ennemies peuvent donner l’exemple d’une réconciliation toujours possible, d’un pont jeté entre deux cultures qui ne demandaient qu’à se rencontrer.