
Frères,
elle est vivante, la parole de Dieu,
énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ;
elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit,
des jointures et des moelles ;
elle juge des intentions et des pensées du cœur.
Pas une créature n’échappe à ses yeux,
tout est nu devant elle, soumis à son regard ;
nous aurons à lui rendre des comptes.
En Jésus, le Fils de Dieu,
nous avons le grand prêtre par excellence,
celui qui a traversé les cieux ;
tenons donc ferme l’affirmation de notre foi.
En effet, nous n’avons pas un grand prêtre
incapable de compatir à nos faiblesses,
mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses,
à notre ressemblance, excepté le péché.
Avançons-nous donc avec assurance
vers le Trône de la grâce,
pour obtenir miséricorde
et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours.
Hébreux 4, 12-16
Textes liturgiques©AELF
Je sais que l’Epître aux Hébreux, dont l’auteur n’est pas clairement identifié, n’a pas toujours bonne presse en théologie.
Cependant, j’avoue qu’elle me parle au cœur. Pour ma part, elle fait écho à mes convictions chrétiennes les plus profondes.
Jésus, le Fils de Dieu, sa Parole vivante et intemporelle, nous révèle mieux que n’importe quelle doctrine antérieure ou postérieure à lui la volonté du Père pour l’humanité dans sa globalité et pour chaque personne dans son individualité. Qui ne pourrait se reconnaître dans tel ou tel personnage de l’Evangile, qui ne pourrait se laisser toucher au cœur par telle ou telle parabole de Jésus ?
L’Evangile peut être à la fois douce consolation dans nos épreuves inévitables, et annonce décapante qui va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit,
des jointures et des moelles ;
elle juge des intentions et des pensées du cœur.
Oui, face à l’authenticité d’un Messie qui n’a pas hésité à donner toute sa vie pour ses amis, ses contemporains et tous leurs descendants et héritiers, comment douter de sa pureté de cœur et d’intentions, de son adéquation sans faille à la volonté du Père, de son innocence désarmante qui témoigne d’une âme et d’une chair exemptes de tout péché ?
Rien n’a été épargné à Jésus en matière de souffrance due à l’iniquité de ses frères en humanité, dont il partageait la ressemblance physique sans être jamais entaché par l’inévitable défiance envers Dieu qui les caractérise depuis les origines. Là où ses propres disciples doutaient de ses inspirations sur les desseins de Dieu et de ses intuitions sur l’issue de sa vie terrestre, là où les gardiens de leur commune religion ne manifestaient aucune confiance en ce jeune prédicateur itinérant alliant pourtant à la perfection la parole et l’agir, Jésus n’a jamais fléchi dans la recherche de la volonté de son Père par sa prière et sa fréquentation des Ecritures, allant jusqu’à accepter pour lui-même tout le poids des prophéties d’Isaïe sur le Serviteur souffrant.
Je lis souvent, et ce matin encore de la part d’une chrétienne pourtant convaincue, qu’il n’est pas bon d’avoir le sentiment de devoir quelque chose à quelqu’un qui se serait “sacrifié” pour autrui. Beaucoup rejettent de nos jours l’idée de sacrifice du Christ sur la croix pour le rachat de l’humanité en matière de péché et de vie éternelle.
Je ne puis partager ces vues. Pour beaucoup de nos contemporains, il est insupportable de se dire que quelqu’un ait eu à souffrir pour offrir à autrui, a fortiori à eux-mêmes, la grâce de la rédemption. Ils considèrent cette question sous un angle tronqué, arguant que Dieu n’est pas sanguinaire pour avoir “désiré” la mort sacrificielle de son propre Fils, comme s’il était assoiffé du sang d’un innocent, condition requise pour accorder sa grâce à l’humanité. Mais raisonnant ainsi, on se fourvoie. On prend le problème par le mauvais bout.
Imaginons un scénario inverse pour la vie du Christ : né dans une famille aisée, il aurait été choyé en toutes choses depuis sa naissance, fait Roi sur terre, aurait été respecté de tous et serait mort dans les honneurs après une longue vie vertueuse et exemplaire. On le vénérerait peut-être comme un souverain exceptionnel, un héros du temps passé, mais qui se frapperait la poitrine en se reconnaissant pécheur devant cette statue de Commandeur ? Qui pourrait avoir le cœur meurtri de contrition devant un portrait de Messie triomphant, élevé sa vie entière au-dessus du commun des mortels ?
Bien au contraire, Jésus voyait juste en affirmant : “Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes.” (Jean 12, 32). Elevé sur la croix de l’infamie, et non sur un trône terrestre de gloire !
Pour Jésus crucifié, d’aucuns peuvent peut-être éprouver du mépris, ce fut son lot et ce l’est encore aujourd’hui, mais de la jalousie, certes non. Il attire bien plutôt la compassion et le remords pour nos propres conforts, infidélités et trahisons des commandements divins, nous qui sommes si facilement pécheurs quand lui, l’innocent absolu, a payé le lourd tribut de l’inconséquence humaine, sans avoir commis aucune faute, ni de parole, ni de comportement.
Alors peut-être faut-il un peu d’humilité vraie et beaucoup de profonde gratitude pour reconnaître que c’est en raison de nos duretés de cœur que le propre Fils de Dieu ne pouvait nous offrir rédemption et espérance de vie éternelle qu’en endurant une mort injuste, lui le Juste par excellence. Que cette destinée tragique s’inscrivait déjà dans les Prophètes bien avant le temps de son incarnation.
Nous traversons une époque d’ingratitude généralisée. De méconnaissance du Père aussi.
Parce que trop de fanatiques renvoient l’image d’un Dieu violent, les chrétiens se taillent volontiers un Dieu faible, sans puissance, humble et effacé, comme si cela paraissait plus convenable à une époque où il semble ne plus agir.
Eh bien, je récuse ces deux visions de Dieu : celui qui opprime aussi bien que celui qui s’efface devant l’homme.
Le Dieu de Jésus Christ, son “Père qui est au Cieux”, n’est pas un Dieu crucifié et inerte, et s’il n’est pas non plus un Dieu vengeur et guerrier, il se situe dans un juste intermédiaire : aimant à se laisser chercher, il se laisse aussi trouver. Aimant à être prié et écouté, il se plaît aussi à exaucer qui l’invoque avec foi. Et ses exaucements, quoique prétendent certains théologiens qui se voudraient plus agissants que Lui sur le monde, défient parfois les “lois terrestres”. Dieu peut se faire entendre et sentir, et accorder grâces inattendues et même guérisons et résiliences inespérées. Et surtout, il n’a pas dit son dernier mot, et manifestera à l’humanité tout entière sa Toute-puissance intacte en envoyant son Fils bien-aimé une seconde fois, pour le jugement des vivants et des morts qui est de son ressort.
Prenons garde de ne pas cultiver l’idée d’un Dieu qui n’agira plus jamais sur une création jadis confiée à l’homme. Que celui-ci ne se gargarise pas d’une responsabilité immuable sur les créatures et les éléments, alors qu’il n’est qu’intendant, et pour un temps limité, d’une planète à bout de souffle par sa faute. Le Dieu auquel je crois est profondément cohérent à travers toute la Révélation biblique, depuis la Genèse jusqu’au terme de l’Apocalypse. Ce qu’il veut réaliser, il lui suffit d’une Parole, et cela devient réalité. A nous de solliciter encore et encore sa force rédemptrice et sa justice, enfin ! A nous de le prier ardemment pour qu’il nous renvoie enfin son Fils !
Amen ! Viens, Seigneur Jésus !
Image : Christ au Mont des Oliviers, vers 1500, Collection du musée Unterlinden à Colmar
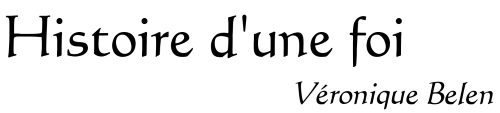










2 commentaires
J’aime beaucoup votre réflexion, et ce d’autant plus qu’elle part d’une “jointure”, d’un écartèlement qui ne me la rend pas immédiatement accessible. Comment comprendre ce Jésus qui peut compatir à nos faiblesses et se fait homme et notre grand prêtre, se montrant capable d’offrir des sacrifices en notre faveur alors qu’il aurait tout assumé de la nature humaine à l’exception de ce qui en constitue la partie incompréhensible et propre à la faire détester, ce mal, ce péché, par lequel l’homme cesse de penser qu’il est bon, qui le dégoûte de lui-même et qui est comme une spécificité de la nature humaine: seul l’homme pèche, les anges choisissent une fois pour toutes d’être du côté de Dieu ou de lui être insoumis, et les animaux obéissent à leurs instincts. Donc dire que Jésus S’est fait homme à l’exception du péché, n’est-ce pas une contradiction dans les termes? Quand je faisais part de ma perplexité auprès d’un ami très girardien (et René Girard a commencé par refuser la lecture sacrificielle de l’épître aux Hébreux), il m’a répondu que le christianisme n’était pas à un oxymore près. La formule m’a plu.
Mais je continue de creuser ma perplexité. Vous écrivez que Jésus n’a commis “aucune faute ni de parole, ni de comportement”. Cela ne se vérifie pas à première vue. Tant de fois il est dur, y compris avec sa mère, Il rabroue ses disciples, Il les menace de l’enfer. Il va presque jusqu’à la violence en renversant les étales des marchand du Temple, l’exemple est topique, mais même en entrant dans sa Passion, avant de demander à ses disciples de rengainer leurs épées, Il se félicite qu’ils en aient acheté. Autrement dit, quand j’essaie de vérifier si Jésus n’a point péché, je commence par trouver que si.
Or mine de rien, vous nous proposez une définition du péché à l’aune de laquelle la vérification s’inverse. Pécher, c’est, dites-vous, “éprouver de la défiance envers Dieu”. Là où nous pensons qu’il faut “tuer le père”, Jésus Lui cherche “à accomplir la Volonté de son Père”, dit qu’Il est venu pour cela, qu’il y trouve sa nourriture et la réalisation de Sa vie, consentant même à endosser la mission du serviteur souffrant.
Vous ne voulez ni du Dieu vengeur ni du Dieu faible et impuissant. Vous continuez de croire au miracle et d’espérer la parousie. Vous dites que Dieu nous attire parce qu’Il ne cesse pas d’agir et qu’Il n’y renoncera jamais. Vous battez en brèche le Dieu évanescent d’une société quiétiste. Parole rare, qui me renvoie en écho celle d’un aumônier d’hôpital disant un jour: “Nous sommes trop rapidement passés d’un Dieu dur à un Dieu mou qui nous permet de nous dédouaner.” Et quand je lui demandais de préciser quel était selon lui le vrai Dieu, il me répondit que c’était le Dieu Père, à la fois exigeant et miséricordieux. Jésus ne cesse donc de nous ramener au Père. Sa cohérence est dans le Père, comme la cohérence de l’aporie entre le Dieu tout-puissant et le Dieu impuissant.
Un père à qui l’on demande du pain ne saurait donner des serpents ou du poison à ses enfants, nous dit Jésus dans l’Evangile, car “même vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants”. Et pourtant le Père de Jésus ne recule pas devant le sacrifice de son Fils unique. Le mysticisme contemporain, puisant parfois aux meilleures sources (je l’ai vu chez une amie véritablement mystique) croit de bon ton de se mettre à distance de la lecture sacrificielle de la passion du Christ. Il le fait, croit-il, par compassion. Or la véritable compassion qu’on doit au Christ, c’est de prendre sa croix et de participer à sa Passion, c’est de ne pas se croire plus fort que Lui, qui ne s’est pas laissé submerger par une logique des événements qui L’aurait dépassé, mais Qui est venu sur terre à la fois pour enseigner et pour marcher vers la souffrance, et pour souffrir, et pour mourir, et pour que cette mort nous apporte quelque chose, nous déleste de nos péchés, nous soustraie au mystère d’iniquité, nous rende libres comme la Vérité qui n’est complète que si l’on ajoute à celle de la mort du Christ la vérité de Sa Résurrection.
Comme beaucoup d’hommes perdus en cette vie où nous marchons sans en comprendre le sens parce que nous ne nous en donnons pas la peine, je me suis souvent amusé à traquer les soi-disants infidélités de Dieu. Aveugle moi-même, je me suis complu à démontrer à un aveugle évangélique qui me guidait qu’un aveugle peut guider un autre aveugle sans que tous les deux ne tombent dans un trou. Je me suis également amusé à relever que “qui cherche” est loin de nécessairement trouver, mais vous avez raison de croire en un Dieu qui se laisse chercher et trouver. Mon meilleur ami me renvoya une question comme je lui demandais ce qu’il pensait de moi. “Veux-tu vraiment entendre la réponse ou poses-tu la question pour le plaisir de la question?” Nous ne trouvons pas Dieu quand nous prétendons Le chercher parce que nous ne voulons pas Le trouver et préférons Le chercher dans et pour le plaisir de la recherche. “Avoir question à tout”, est stimulant et “en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses” disait Karl Jaspers, car les questions sont des mots de l’enfant des “pourquois”. C’est sans doute exact, mais qu’en est-il de notre vie si elle ne s’oriente pas vers une réponse? Car compte au premier plan l’orientation fondamentale que nous lui donnons et le “vouloir foncier” qui indique le sens de la marche d’un être humain. Je ne sais pas si nous serons jugés à l’aune de ce “vouloir foncier”, et de cette orientation fondamentale, mais notre vie appelle réponse.
Nous ne voulons “rien devoir” au sacrifice du Christ parce que, comme me le disait l’abbé Yannick Vella lors d’une conversation au débotté dans un hôtel albigeois, nous traversons depuis très longtemps une crise de la pensée sacrificielle. Cela a commencé dès le judaïsme que l’effet cumulé de la Passion du Christ et de la destruction du Temple a fait passer d’un judaïsme sacerdotal (et donc de sacrifice) à un judaïsme rabbinique (de simple enseignement), de même que nous voudrions bien sinon d’un “christianisme sans la Croix” comme le déplorait déjà Paul VI; du moins souhaiterions-nous passer d’un christianisme kérigmatique à un christianisme évangélique.
“La Passion du Christ va beaucoup plus loin qu’un simple mystère de mort et d’ensevilissement”, ajoutait l’abbé Vella. “Benoît XV (dont il ne retrouvait pas la citation exacte) parle de destruction de la victime, la victime est brûlée, la descente aux enfers est un moment de consomption, la Résurrection du Christ ne vient qu’à ce prix-là”.
Nous dénions toute valeur au sacrifice, car nous tenons absolument à être responsables de notre vie. Le sacrifice est douloureux, mais notre consentement à cete douleur de la perte entraîne paradoxalement une moindre responsabilit de notre part une fois le sacrifice consommé. Et si nous devons le pardon de nos péchés au sacrifice d’un autre, nous nous sentons amputés de notre responsabilité.
Jusqu’à mieux définie, la Rédemption est un transfert de responsabilité. J’écris cela en ayant essuyé les foudres de beaucoup de commentateurs d’un autre blog pour avoir avancé cette définition, mais on ne me propose pas de définition alternative.
La crise de la pensée sacrificielle est l’autre nom d’une allergie qu’éprouve aujourd’hui notre Occident démocratique (et où la démocratie se porte mal) pour toute forme de verticalité et de sacralité. La lutte contre le cléricalisme est l’implicite du refus par incompréhension du sacerdoce en tant que tel, du sacerdoce ordonné comme du sacerdoce du Christ, car le prêtre produit du sacré, et l’Incarnation du Christ n’a pas désacralisé la divinité du Christ, à preuve son refus du péché. Elle a sacralisé ou plutôt divinisé l’homme s’il veut bien entrer dans le projet de cette divinisation et ne pas se la donner par impossible à lui-même.
Merci beaucoup Julien Weinzaepflen pour ce commentaire nourri et fort intéressant. Vous avez bien compris ce que je voulais exprimer, et je vous en remercie.
Il me semble que dénier la dimension sacrificielle de la vie du Christ procède un peu de la même réticence que l’aversion qu’éprouvent certaines personnes à ce que l’on prie pour elles. Encore un effet de cette obsession à “avoir la main” absolue sur sa propre vie.
Or, et j’y pensais en rédigeant cette méditation, il existe des personnes qui sacrifient beaucoup de leur propre vie pour intercéder pour autrui et pour le monde : ce sont les “grands priants”, ces moines et moniales reclus, qui renoncent à la vie mondaine et simplement à la réalisation de soi par la carrière, la famille, les interactions sociales, pour se cacher en Dieu et le prier sans cesse. Je ne dis pas que cette vie choisie ne leur apporte rien sur le plan personnel. Mais elle procède d’une décentration de soi-même, au moins au moment de la vocation, des vœux et par la durée, et ce pour mieux prier pour autrui. N’avons-nous pas tous, à un moment ou un autre de notre vie, le réflexe de solliciter la prière d’une communauté religieuse devant telle difficulté de la vie rencontrée par nous-même ou un proche ? Ne sommes-nous pas rassurés de penser que là, au fond d’un monastère, des âmes désintéressées intercèdent pour nous qui sommes plongés dans les affres du monde ?
Je pense depuis longtemps que les vocations contemplatives ne sont pas des fuites devant des difficultés existentielles, pas plus que des manières égoïstes de vivre l’Evangile. J’ai eu maintes fois à m’opposer aux défenseurs de l’Evangile “utilitaire” qui reprochent aux contemplatifs de ne rien faire pour leur prochain. Quelle erreur d’appréciation ! En certaines circonstances de la vie, on a davantage besoin de la prière ardente et désintéressée d’autrui que d’un coup de main concret ou d’une offrande pécuniaire.
Il faut lire l’œuvre des âmes ainsi données à la prière dans le renoncement à bien des conforts pour comprendre la dimension sacrificielle d’une telle vie, dans la continuité et le même désintéressement immédiat que celle du Christ Jésus. Je pense par exemple à Elisabeth de la Trinité, qui exprime très bien son choix du Carmel à l’âge où sa famille voulait lui assurer une vie aisée par un mariage mondain. Quand elle ou Thérèse de Lisieux disent “Ah Jésus, je veux souffrir pour toi !”, on se récrie de nos jours en parlant de “dolorisme”, un mot que je déteste. Elles et leurs sœurs de vocation n’ont pas choisi de “souffrir pour souffrir”, mais d’immoler leurs charmes et leur jeunesse pour se faire plus proches de leur Bien-Aimé, et ainsi d’ouvrir leurs cœurs à la dimension du monde, par l’intercession et le don d’elles-mêmes, comme le Seigneur Jésus lui-même l’a fait.
Je ne sais plus qui disait qu’au moment de la mort, il nous sera connu qui a prié pour nous au long de notre vie, et que nous en serons confondus de honte et de reconnaissance à la fois. Je suis ardemment persuadée qu’aucune prière n’échappe au grand cœur du Père, qu’Il ait eu l’air d’y répondre, ou pas.